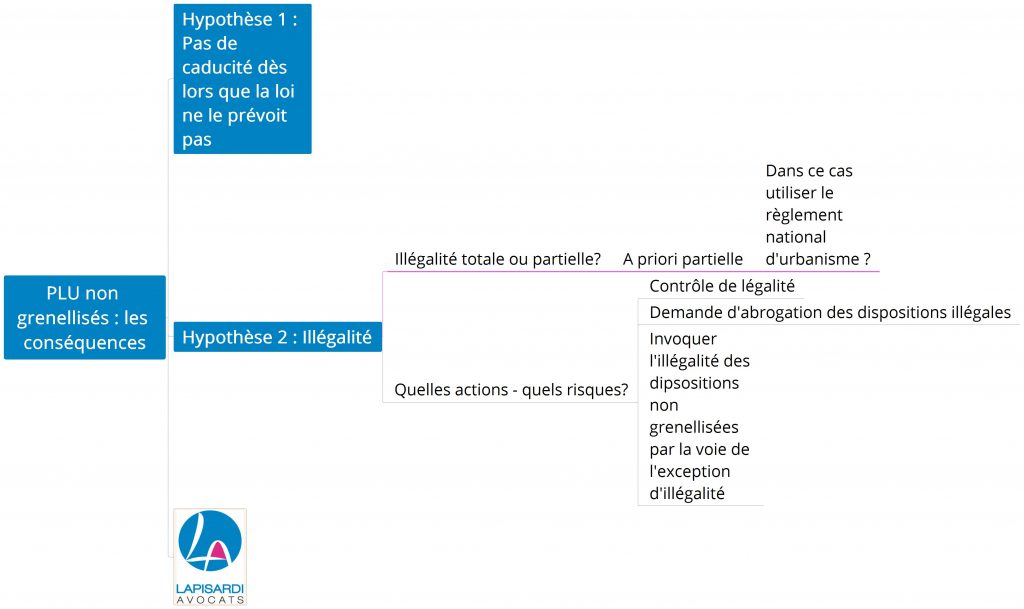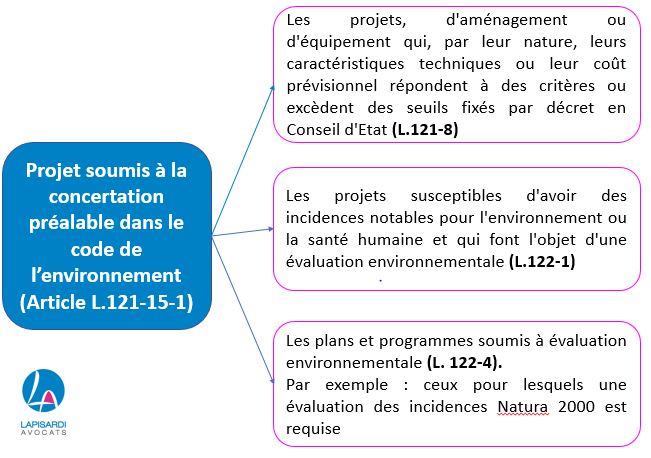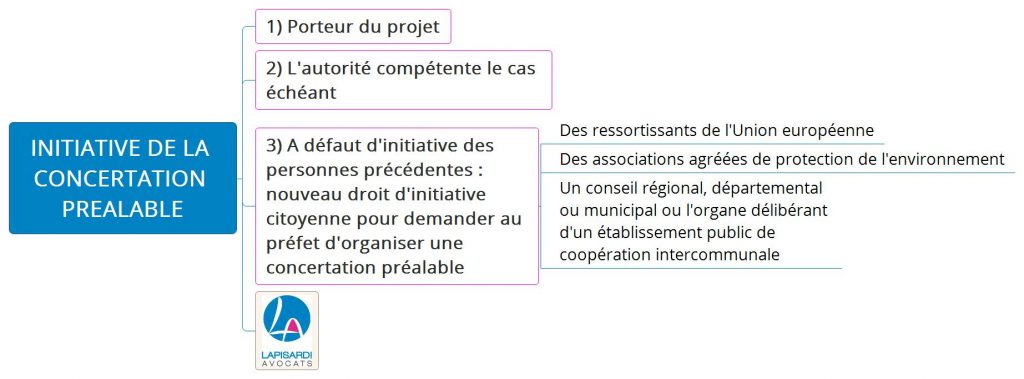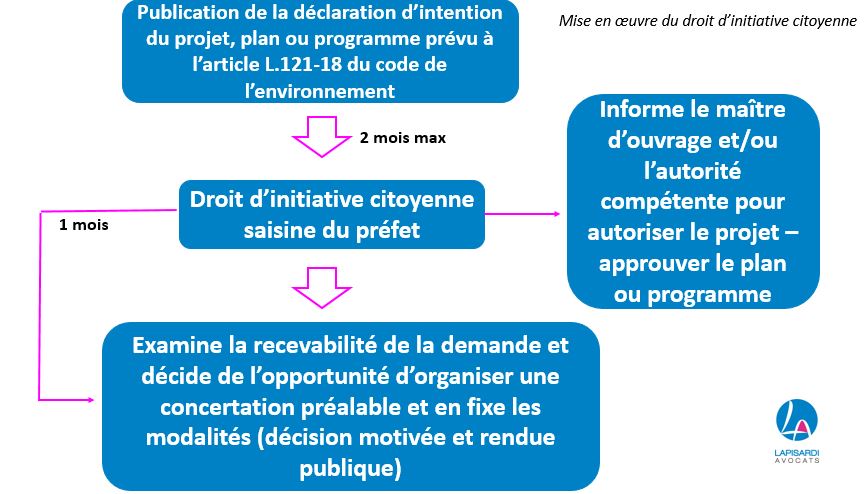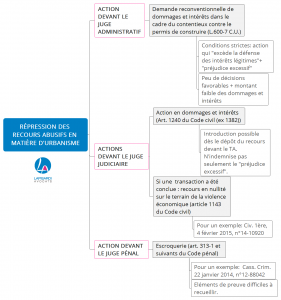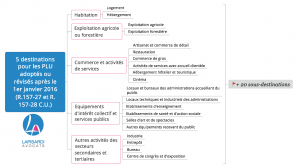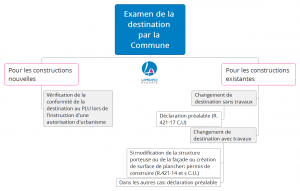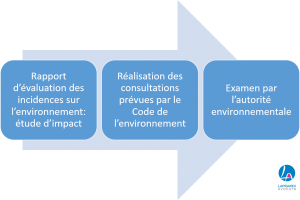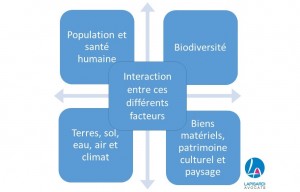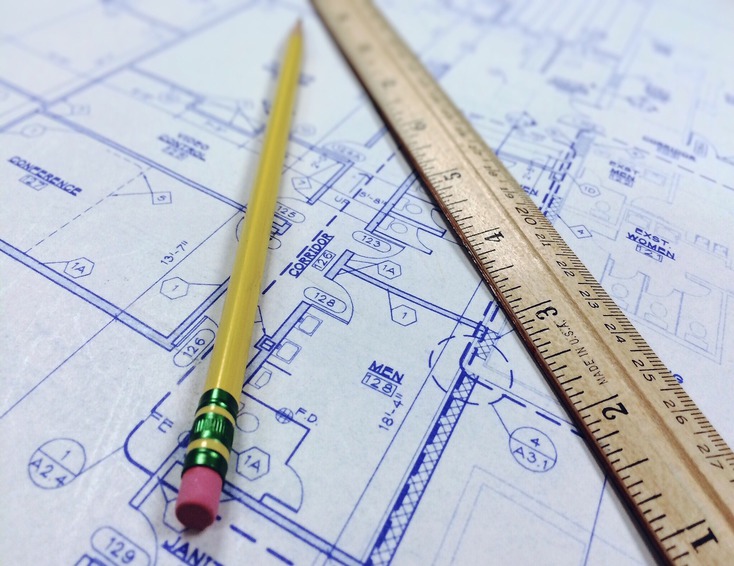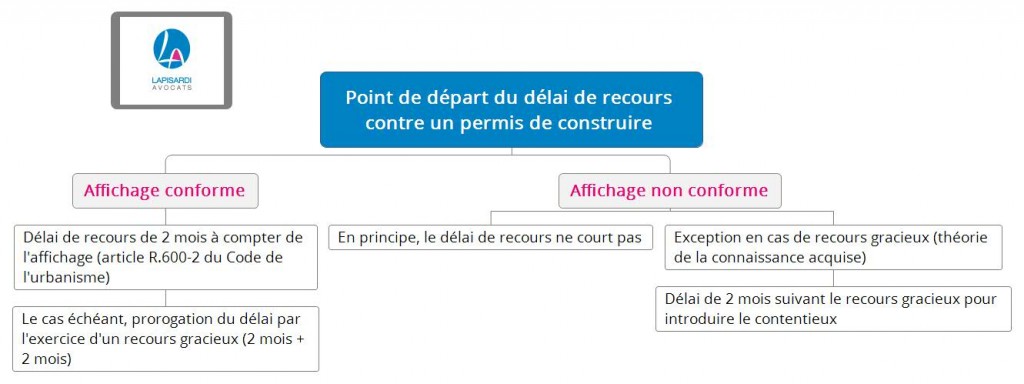Dans une décision du 22 février 2016 (CE, 22 février 2016, Société d’aménagement de Piossane III, n°367901), le Conseil d’Etat a eu à connaître de la légalité d’une délibération modifiant un plan local d’urbanisme pour interdire les installations classées dans un secteur de la Commune. Or, avaient pris part au vote de cette délibération deux conseillers municipaux, anciens membres d’un collectif de riverains opposé à la présence d’une centrale d’enrobage dans le secteur en cause. Le juge devait donc déterminer si ces deux élus étaient des « conseillers intéressés » au sens de l’article L.2131-11 du CGCT.
Pour mémoire, l’article L.2131-11 du CGCT dispose que : « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Dans sa décision du 22 février, le Conseil d’Etat affirme que l’article L.2131-11 du CGCT n’interdit pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d’une association de prendre part à la délibération modifiant le PLU et restreignant certaines activités classées sur le territoire de la commune, alors même que l’association en cause avait pour objet l’opposition à ces activités.
Le Conseil d’Etat considère que ces élus n’ont pas influencé le conseil municipal pour des motifs d’intérêt personnel. Dès lors, le Conseil d’Etat rejette le moyen tiré de la violation de l’article L.2131-11 du CGCT.
Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’Etat se prononce sur la délimitation entre intérêt personnel et intérêt communal des membres du conseil municipal.
Déjà, dans une décision du 17 novembre 1999 (CE, 17 novembre 1999, Association des usagers de Peyreleau, n°196531), le Conseil d’Etat déclarait que la participation de plusieurs conseillers, membres d’une association créée avant l’élaboration d’un projet de mise en valeur des espaces naturels, ne viciait pas la délibération du conseil municipal donnant avis favorable à ce projet, alors même que l’association devait être ultérieurement chargée de la gestion de la réserve naturelle.
En revanche, la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 10 décembre 2015, Société Ozone, n°13VE02037) a récemment affirmé qu’était viciée la décision d’attribuer un marché à une association dont le Vice-président a, en sa qualité d’adjoint au maire, présidé la commission d’appel d’offres. Le juge considérait que la personne en question avait eu un intérêt distinct de celui de la commune, à l’attribution du marché, nonobstant l’exercice à titre gratuit de ses fonctions dans l’association et sa présence dans cette dernière en qualité de représentant du département, membre de droit.
La jurisprudence est donc nuancée et invite les élus à la plus grande prudence.
Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour, et Mickael Laurent, stagiaire au Cabinet -Master 2 Droit public des affaires.