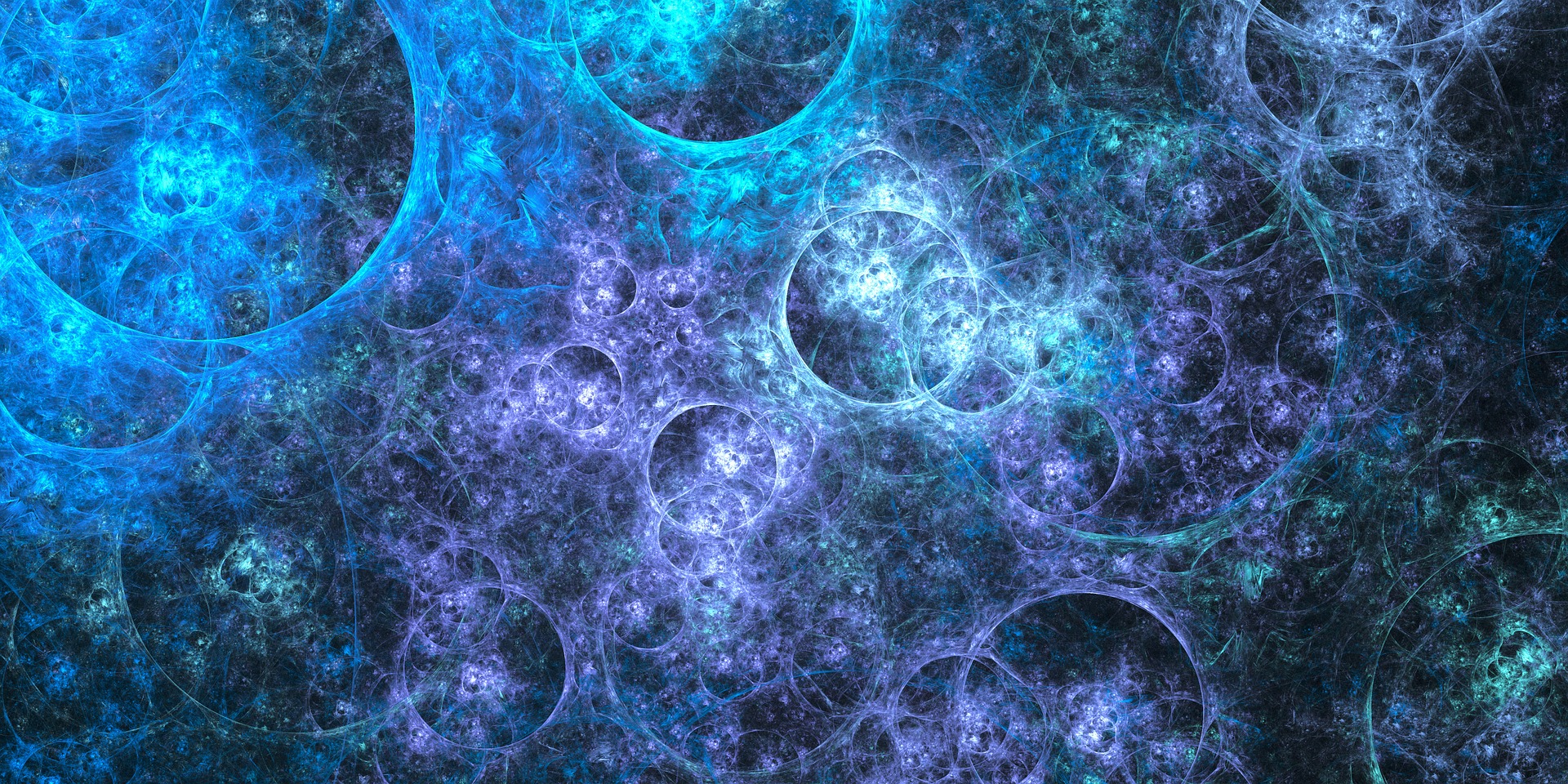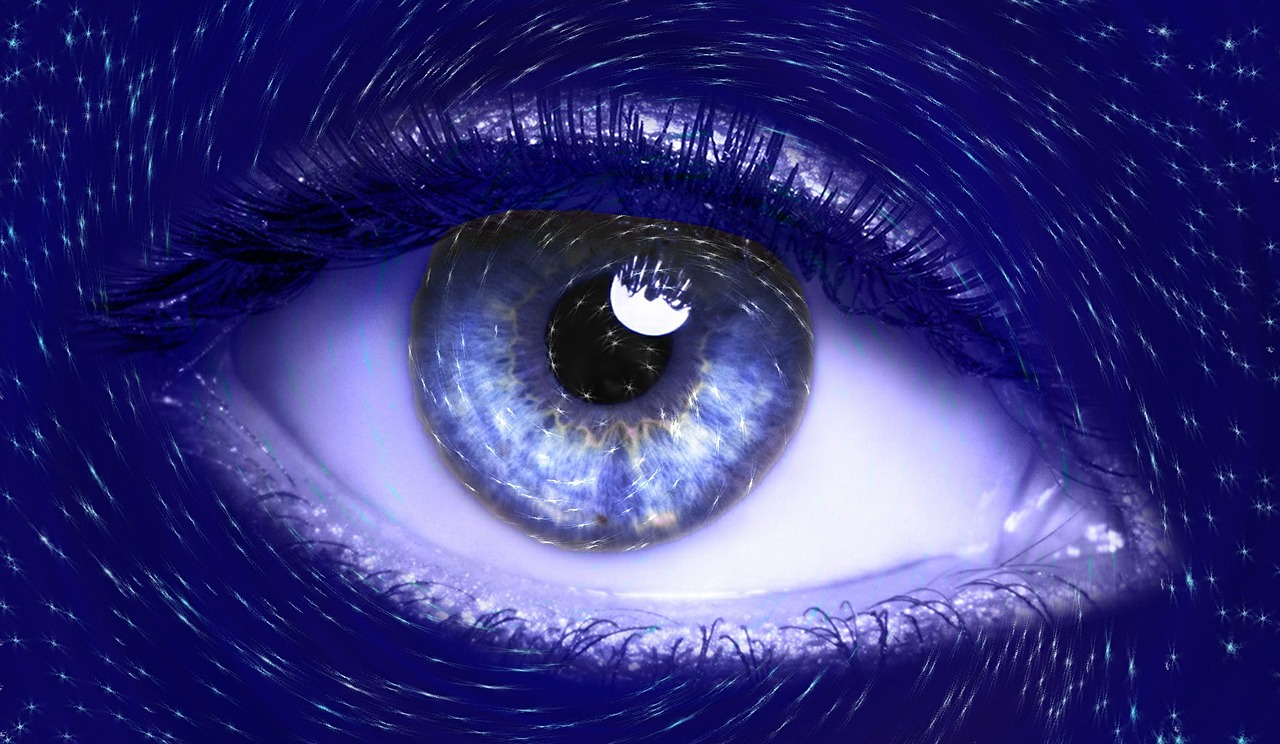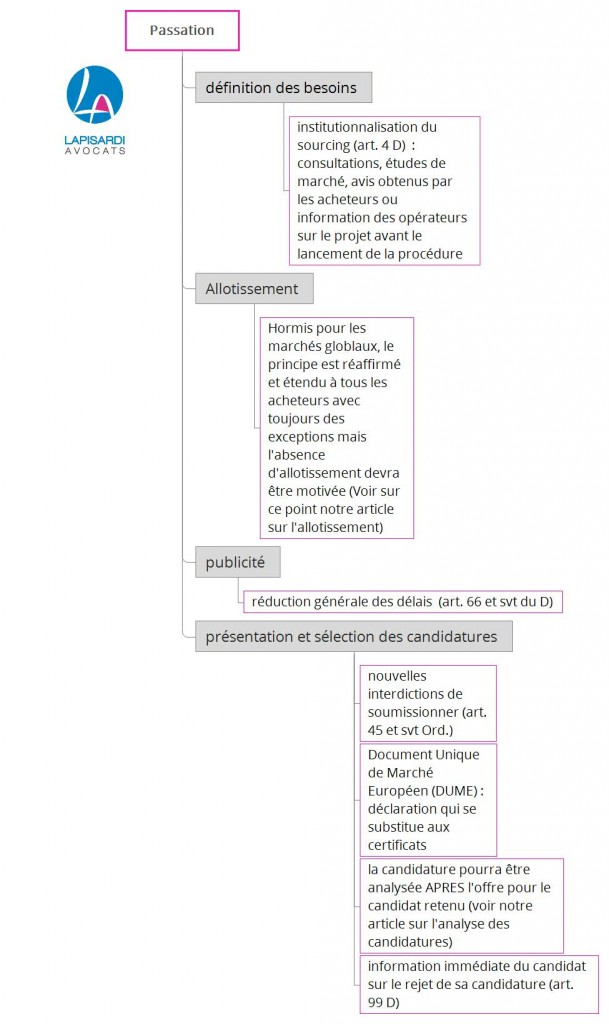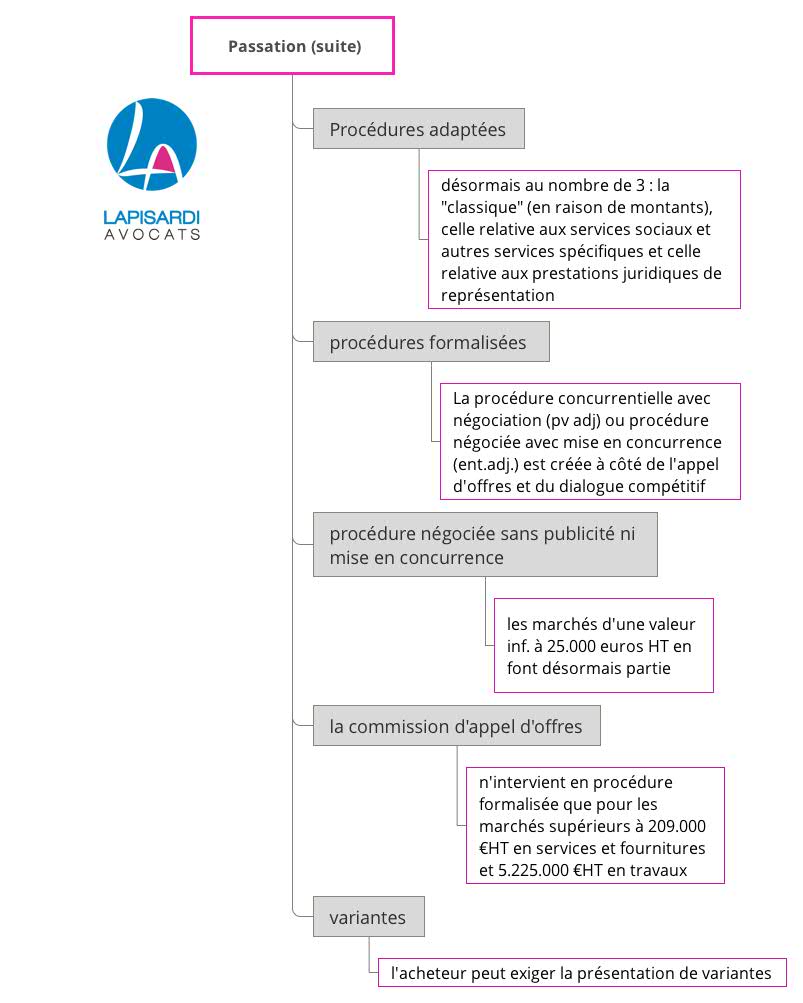Voir notre article en format PDF
Alors que la réforme des marchés publics est venue renforcer le principe d’allotissement, le Conseil d’Etat vient d’emprunter le chemin inverse pour les délégations de service public (DSP) en validant :
-
Le principe même d’une DSP multi-services publics ;
-
et la possibilité de mettre à la charge du délégataire des prestations accessoires qui présentent un caractère complémentaire à l’objet de la délégation (CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon n°399656).
Dans cette affaire, la communauté urbaine du Grand Dijon (CUGD) avait lancé une procédure pour la passation portant sur « l’exploitation des services de la mobilité » regroupant les services de transport urbain, de stationnement et de mise en fourrière.
Trois sociétés, qui estimaient que ce périmètre trop large de la délégation de service public les avait dissuadées de présenter leur candidature, ont attaqué la procédure en référé précontractuel.
La consécration du principe d’une DSP multi-services
Le Conseil d’Etat constate tout d’abord qu’« aucune disposition législative ou principe général, n’impose aux collectivités qui désirent confier à un opérateur la gestion de services publics dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts ». Il est vrai que le principe de l’allotissement ne concerne que les marchés publics et non les concessions et les DSP.
Toutefois, si le principe est effectivement affirmé, deux tempéraments sont immédiatement apportés afin de ne pas méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence :
- le périmètre ne doit pas être manifestement excessif ;
- et il n’est pas possible de réunir au sein d’une même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux.
La DSP de la CUGD est validée car le juge considère que « les services de transport urbain, de stationnement et de mise en fourrière, qui concourent à l’organisation de la mobilité des habitants sur le territoire de la communauté urbaine présentent entre eux un lien suffisant » et que la CUGD pouvaient ainsi les confier à un même prestataire « afin d’assurer une coordination efficace entre les modes de transport et de stationnement, dont une partie significative des usagers est identique ».
Nous le voyons, plusieurs pistes sont avancées pour justifier du lien suffisant entre les services publics :
- Le fait que ces services poursuivent le même objectif ;
- Et qu’ils aient une part significative d’usagers en commun.
La possibilité de mettre à la charge du délégataire des prestations accessoires qui présentent un caractère complémentaire à l’objet de la délégation
En outre, les requérants soutenaient que l’autorité délégante avait mis à la charge du délégataire des services et paiements étrangers aux services publics : certaines missions de vérification de la performance et du fonctionnement des transports, des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage du projet Prioribus, et de maîtrise d’œuvre pour le déploiement de certains matériels (violation de l’article L. 1411-2 du CGCT aujourd’hui notamment article 30 et article 31 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016).
Mais le Conseil d’Etat rejette également ce moyen en affirmant que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une convention de DSP mette à la charge du cocontractant des prestations accessoires dès lors qu’elles présentent un caractère complémentaire à l’objet de la délégation ».
Voici un arrêt qui ouvre de nouvelles perspectives aux personnes publiques notamment dans le domaine de la mobilité et des villes intelligentes.
Pour les entreprises en revanche, elle complique la donne. En effet, l’exploitation de certains services publics peut être confiée par le biais d’un marché public ou d’une délégation de service public selon que la personne publique transfère ou non le risque d’exploitation. Aussi, selon les cas, ces opérateurs économiques devront soit présenter une offre pour un service public (marché public), soit répondre à une DSP multi-services publics avec la plupart du temps l’obligation de se présenter en groupement avec d’autres entreprises.
En somme, les entreprises doivent, elles-aussi, se préparer à devoir présenter des offres à géométrie variable.
Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public